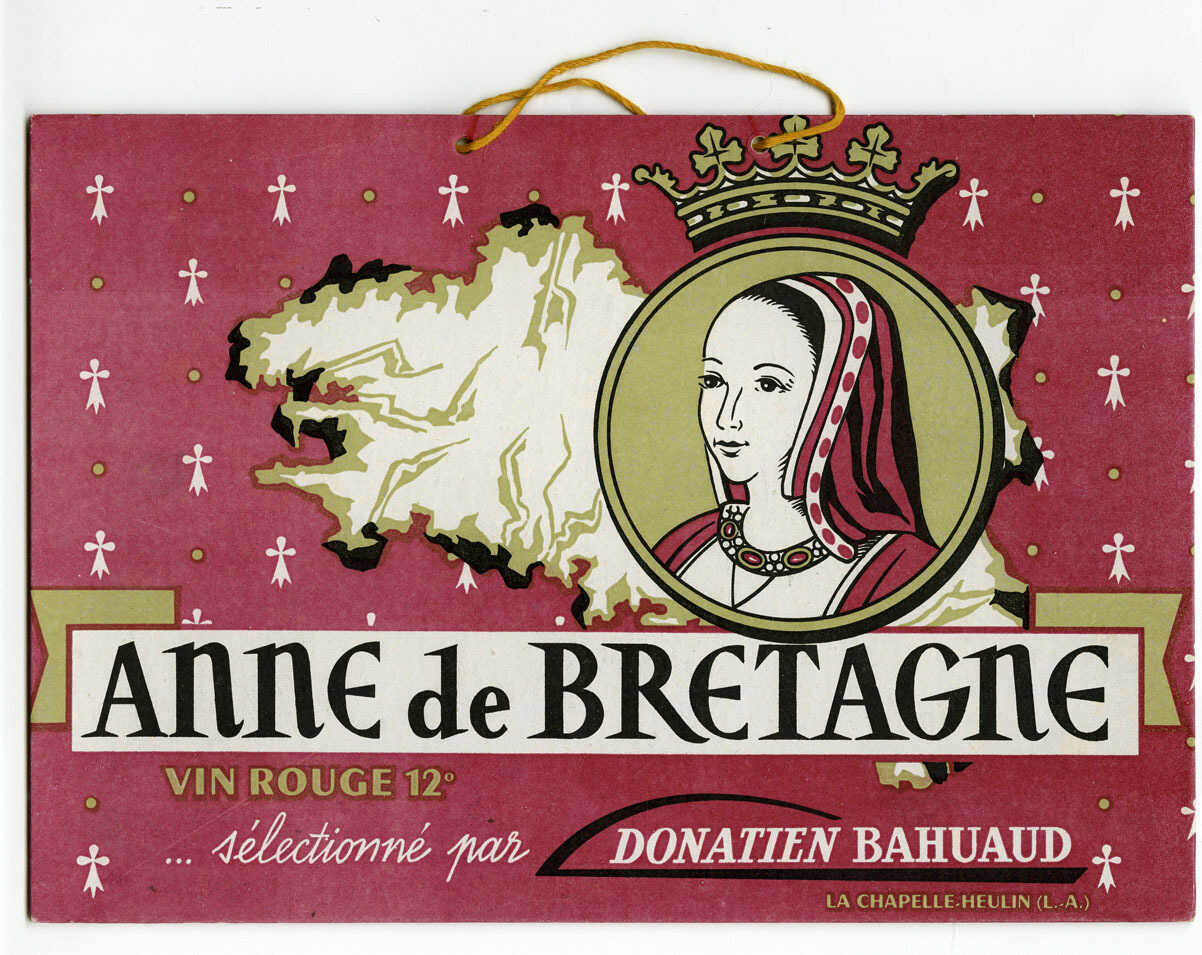
Anne de Bretagne (duchesse, 1477 – 1514)
Anne de Bretagne, fille aînée du duc François II et de sa seconde épouse, Marguerite de Foix, naît le 25 janvier 1477 dans une chambre du vieux logis du château de Nantes alors en pleins travaux. Elle passe son enfance entre Nantes, Vannes et Clisson.
Un mariage de raison
Elle devient duchesse de Bretagne après la mort de son père en septembre 1488 mais, du fait de son opposition au projet d’union avec Alain d’Albret, elle perd le contrôle de Nantes et doit se réfugier à Rennes où elle épouse par procuration Maximilien, roi de Rome et maître des Pays-Bas (décembre 1490). Dans l’immédiat, ce dernier ne peut lui être d’aucune aide et Anne reste seule face au roi de France Charles VIII qui ne veut pas d’une telle alliance. Dans la nuit du 19 au 20 mars 1491, Alain d’Albret livre Nantes aux troupes royales et, au début de mois de septembre, Rennes est encerclée. Sous la pression de leur entourage respectif, Anne et Charles VIII acceptent finalement un mariage de raison qui est célébré à Langeais le 6 décembre 1491, préparant ainsi l’union de la Bretagne au royaume.
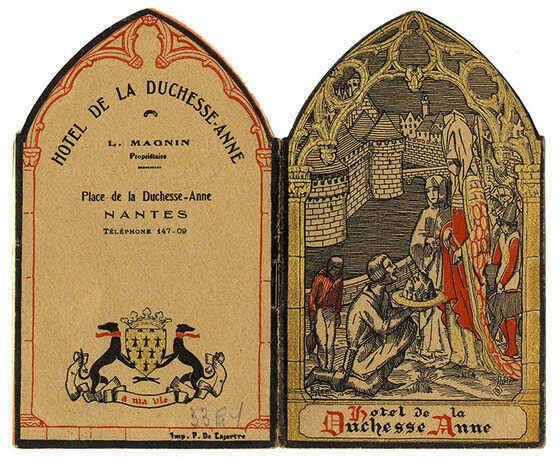
Fascicule publicitaire de l'hôtel de la Duchesse Anne
Date du document : vers 1920
Travaux au château
À partir de 1491, Anne réside principalement dans le val de Loire, d’abord à Amboise, sous le règne de Charles VIII, puis à Blois quand elle se remarie en 1499 avec son successeur Louis XII. Elle vient cependant à plusieurs reprises à Nantes, notamment en 1498, au moment de son veuvage – elle fait battre à cette occasion une monnaie d’or, la cadière –, en 1499 – son second mariage y est célébré – et en 1505 dans le cadre du tour de la Bretagne qu’elle accomplit alors. La fréquence de ses visites entraîne la reprise des travaux au château dont l’enceinte est complétée grâce à l’aménagement des tours du Port, de la Loire et du Fer-à-cheval. Les capacités d’accueil sont améliorées par l’achèvement du Grand logis – dont la lucarne centrale est ornée de la devise de la duchesse « Amavi » (« J’ai aimé ») – et de la tour de la Couronne d’or, qui est surmontée de loggias à l’italienne. Le mobilier est reconstitué et une bibliothèque de près de 1 500 volumes est mise en place.

Affichette publicitaire Anne de Bretagne
Date du document : sans date
Son cœur est à Nantes
Anne meurt le 9 janvier 1514 à Blois à l’âge de 37 ans ; son corps est inhumé à Saint-Denis alors que son cœur est déposé à l’église des carmes de Nantes dans un superbe reliquaire aujourd’hui conservé au Musée Dobrée. Cette double sépulture, qui était ordinaire pour les princes de l’époque, devient, avec le temps, le symbole d’une vie partagée entre Bretagne et France.
Après sa mort, Anne entre progressivement dans la légende. À la suite de Bertrand d’Argentré, des historiens l’ont dépeinte comme un véritable chef d’État, symbole de la résistance bretonne à l’intégration au royaume de France ; d’autres, plus critiques, ont dénoncé le caractère néfaste de son influence, à l’instar des historiens républicains du 19e siècle, ou ont minimisé son rôle comme ses biographes les plus récents. À l’image de la princesse gardienne des privilèges de la Bretagne sous l’Ancien Régime a succédé celle de la duchesse en sabots, paysanne et catholique du 19e siècle. Aujourd’hui c’est le destin de la femme, duchesse à 11 ans, reine à 14 ans et décédée à 37 ans après avoir vu mourir sept de ses neuf enfants qui retient peut-être le plus l’attention. Au gré de ses métamorphoses et des débats auxquels elle a donné naissance, Anne de Bretagne est ainsi progressivement entrée dans la mémoire collective.
Dominique Le Page
Extrait du Dictionnaire de Nantes
2018
(droits d'auteur réservés)
En savoir plus
Bibliographie
Anne de Bretagne : une histoire, un mythe : exposition, Musée du château des ducs de Bretagne, Nantes, Somogy, Paris, 2007
Hamon Philippe, « Du berceau au reliquaire : Nantes et Anne de Bretagne entre histoire et mémoire », Place publique Nantes Saint-Nazaire, n°46, juillet-août 2014, p. 86-93
Le Fur Didier, Anne de Bretagne : miroir d’une reine, historiographie d’un mythe, Guénégaud, Paris, 2000
Le Page Dominique, Anne de Bretagne duchesse et reine : la fin de la principauté bretonne, Ed. du château des ducs de Bretagne, Nantes, 2018
Minois Georges, Anne de Bretagne, Fayard, Paris, 1999
Webographie
La cadière d'or d'Anne de Bretagne
![]()
Les manuscrits d'Anne de Bretagne à la Bibliothèque municipale
![]()
Pages liées
Tags
Contributeurs
Rédaction d'article :
Dominique Le Page
Vous aimerez aussi
Usine des eaux de la Roche
Architecture et urbanismeLa Régie de l’eau de Nantes Métropole, située boulevard Sébastopol est une des plus anciennes industries nantaises encore en activité. Depuis sa construction au cours du 4e quart du...
Contributeur(s) :Anaïs Mailet , Noémie Boulay
Date de publication : 13/10/2020
6972
Bois
Société et cultureNantes, capitale du bois, le propos est sans doute excessif mais pas totalement inapproprié. Depuis toujours il constitue une part importante du trafic du port ; autrefois le bois de...
Contributeur(s) :François Macé
Date de publication : 23/02/2022
2870
ASPTT Salle Georges-Ovinet
Architecture et urbanismeForte de ses 27 sections sportives, l'ASPTT de Nantes est une des plus importantes associations omnisports de l'Ouest. Son histoire commence en 1943.
Contributeur(s) :Nathalie Barré , Jean Brevet
Date de publication : 22/02/2019
3030